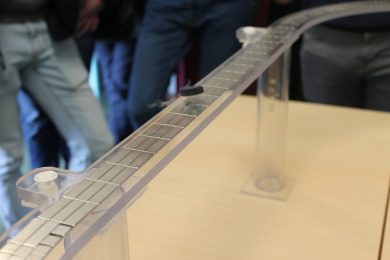Nous, élèves de cinquième gym, avons rencontré la lauréate du prix Rossel 2011 ce jeudi 22 mars.
Mère de trois jeunes enfants, elle nous a raconté comment elle associe son rôle de mère à sa vie d’écrivain. Nous avons appris à la connaître un peu plus, ainsi que le métier d’auteur.
Elle nous a expliqué comment lui était venue l’envie d’écrire, d’où elle tenait son inspiration, son chemin artistique, comment elle vivait cette passion ; elle nous a décrit également en quoi consiste son métier, et quelle joie elle a ressentie en remportant le prix Rossel.
Geneviève Damas a imposé, en toute simplicité, son univers en signant son premier roman : Si tu passes la rivière…
Celui-ci dévoile la vie de François Sorrente, jeune paysan au destin très tourmenté.
L’histoire commence par un avertissement ou plutôt une interdiction : l’interdiction de passer la rivière. Le père de François ne lui laisse pas le choix. François Sorrente, le héros, est le cadet d’une famille de cinq enfants : l’aînée est Maryse, partie sans explication au-delà de la rivière, puis viennent les trois frères : Jules, Arthur et Jean-Paul qui s’est suicidé pour une raison qui sera révélée plus tard dans le roman. François s’interroge souvent sur le départ de Maryse et l’absence de sa mère. Tout au long du roman, nous, lecteurs, sommes plongés dans la tête de François. François, au début, ne fait que s’occuper des cochons, qu’il considère comme ses amis ; mais au fur et à mesure il devient un homme, apprend à ne plus avoir peur des mots et change sans s’en rendre compte.
La lecture du livre a enthousiasmé et ému une grande majorité de la classe qui le trouve très divertissant, amusant et captivant ; le langage employé est familier mais correctement adapté à la classe sociale de François. Les personnages sont très attachants et complètement différents les uns des autres. Chaque individu a son caractère, sa façon de penser, ses qualités comme ses défauts. La fin ouverte laisse au lecteur la possibilité d’imaginer tout et n’importe quoi. Chacun d’entre nous a d’ailleurs rédigé une « dernière page » qu’il a remise à Geneviève Damas le jour de la rencontre.
Geneviève Damas est arrivée vers 8h20, avec son énergie et son livre plein de post-it qui marquent les extraits qu’elle voulait nous lire. Par manque de temps, elle n’a pu en lire qu’un, le début de l’histoire. Elle a été très surprise par la mini expo sur le thème du livre que nous avions installée et a apprécié les suites imaginées par chaque élève. Après la lecture, un petit silence s’est installé. Le stress de la première question ? Mais celui-ci ne dura qu’un moment …
Voici l’interview de la détentrice du prix Rossel :
- Pourquoi « fada » qui fait méridional ? Où et quand se passe l’histoire ?
On m’a souvent posé cette question.
En fait, je n’avais pas envie que François utilise seulement le mot « fou » pour se définir. Je trouve que « fada », ça reprend pleins de significations : fou, original, la tête dans les nuages, toujours dans la lune,… Bien sûr « fada », comme me l’a fait remarquer un ami, fait très méridional et mon histoire, on ne l’imagine pas tellement dans le sud.
En même temps, je me suis dit que je pouvais prendre cette liberté car le lieu n’est pas vraiment défini. Mais cette expression m’aide aussi à montrer au lecteur que François n’est pas dans des mots précis, au début de l’histoire. Maintenant pour le lieu, dans ma tête, l’histoire ne se passe pas dans le nord de la France. La maison des Sorrente se situerait plus dans les environs du Périgord.
C’est mon interprétation, mais je pense tout le temps que le lecteur a toujours raison ! Une fois que le livre a été écrit, chacun en tire sa propre version et si quelqu’un voit mon histoire dans le nord ou en Angleterre, il a raison …
Au point de vue de l’époque, pour moi, le livre se déroule dans les années 50/60, puisqu’on a quand même une camionnette. J’aimais bien cette idée qui me rappelle mes vacances dans la campagne française, dans le Périgord. Là-bas, on a l’impression que tout est resté tel quel, immuable …
Jusqu’au moment où François maîtrise les mots, son monde ne peut se transformer mais après tout s’accélère pour lui ! C’est cela que je voulais faire comprendre au lecteur.
- Pourquoi cette fin ouverte ?
C’est l’héritage du théâtre.
Au théâtre, on mise beaucoup plus sur l’implicite que sur l’explicite pour que le personnage puisse vivre dans la tête du spectateur. Dans mon roman, j’ai voulu laisser le personnage dans la tête du lecteur pour qu’il puisse le faire vivre. Car à la fin de mon livre, ce n’est plus mon personnage mais le personnage du lecteur. Il peut imaginer tout et n’importe quoi ! Certaines personnes penseront que François va mourir noyé, d’autres ne le penseront pas. François Sorrente n’est plus à moi mais à vous. Chacun lui a donné un visage, une vie dans un espace imaginaire,…
Moi, je ne pense pas qu’il meurt mais chacun peut avoir sa propre fin.
La dernière phrase (« C’était froid ») montre que tout n’est pas fini, qu’il reste encore du chemin à faire, que ce ne sera pas forcément facile et qu’il reste encore plein de choses à faire.
- Quel rapport entre vos études de droit, votre passion pour le théâtre et ce roman ?
C’est très complexe … Parce que j’avais un avis sur cette question-là quand j’étais aux études et j’en ai un autre aujourd’hui.
Tout d’abord, j’étais l’aînée de ma famille et moi, personnellement, je trouve que les parents sont plus stricts avec les aînés que les suivants. Parce que l’aîné doit réussir, il doit être bien éduqué, …
Et moi dans ma famille, d’un côté, ils sont tous dans le droit (avocats, magistrats,…). Ma mère voulait faire des études de droit. Elle réussissait. Mais mon grand-père, très vieux jeu, trouvait qu’une femme devait rester au foyer !!! Elle a dû donc arrêter ses études, ne pas travailler, ce fut le gros chagrin de sa vie.
Et donc, quand j’étais enfant, on ne me disait pas « tu vas faire tes études » mais « tu vas faire ton droit ».
Mon père, comme je suis l’aînée, m’emmenait souvent voir du théâtre, des musées, des films… pour ma culture générale. Mais moi ce qui m’intéressait dans tout ça, dès sept ans, c’était le théâtre, la scène… Je voulais être actrice. Quand j’ai enfin osé le dire à mes parents, ça a été une catastrophe !!! Ils ne voulaient pas d’une fille actrice car une vie d’acteur ce n’est pas stable, ça ne gagne pas… Ils n’ont plus voulu que je reste dans les troupes auxquelles j’appartenais. J’ai donc fait mes études de droit !
La première année, j’ai été énormément déprimée.
La deuxième, j’ai trouvé une pièce de théâtre. C’est le trimestre où j’ai le mieux réussi dans mes études de droit. J’ai décidé, suite à cette expérience, de m’inscrire au conservatoire en déclamation, en parallèle avec mes études de droit.
Pour moi, le droit donne beaucoup de culture générale, aujourd’hui je trouve ces études intéressantes. Quand j’y étais, je maudissais ces études, elles étaient un obstacle à ma passion. J’avais peur de ne jamais pouvoir exercer dans le théâtre.
Après mes études, j’ai été à l’IAD et j’ai continué dans le théâtre.
Aujourd’hui j’ai conscience que le droit m’a donné un bonus, une structure pour le théâtre. Pouvoir parler, demander des subventions, rechercher des organisateurs, signer des contrats font partie de la vie quotidienne d’un acteur.
Autant j’ai maudit mes parents à l’époque, autant aujourd’hui je les remercie.
Pour en arriver au roman, le théâtre m’y a amenée. Avant le théâtre j’aimais lire, mais à partir du moment où j’ai commencé à jouer, ça a été une transformation de ma vision de la littérature. Je trouvais certains textes beaux. Et d’une certaine façon, le texte de théâtre est le cousin de la littérature romanesque. Et évidemment, les études de droit sont des études littéraires. Ce sont toutes ces petites choses qui m’ont amenée à l’écriture de mon roman.
- Pouvez-vous nous parler de votre carrière au théâtre ?
Je sors de l’I.A.D., une école assez physique mais avant ça, je faisais des études de droit et payer une deuxième école était impossible donc mes parents m’ont dit : « Si tu veux faire du théâtre, tu devras payer tes études. » J’ai trouvé du travail dans une salle de théâtre, c’était une opportunité pour moi, en journée je suivais mes cours de théâtre et le soir j’allais au spectacle ; à force de regarder 25 fois le même spectacle, eh bien je savais ce que j’aimais et ce que je détestais, ça m’a permis de former mon regard. J’ai rencontré un metteur en scène, qui m’a proposé de faire des assistanats, c’était un super metteur en scène qui arrêtait sa troupe quand je ne comprenais pas une chose pour m’expliquer. De là j’ai travaillé de plus en plus sur des projets en France, au Japon, pour les petits enfants. Ensuite j’ai travaillé sur Molière avec Jacques Delcuvellerie, un assistanat éprouvant. Je faisais beaucoup d’adaptations romanesques en théâtre, c’était un peu ma manière de commencer à écrire, je crois. Parallèlement à ce gros projet de Molière, j’ai adapté un auteur québécois. Il m’avait invitée au Québec mais le projet est tombé à l’eau, car il a reçu une offre plus prometteuse pour lui. J’ai alors écrit un texte qui s appelait “Molly à vélo” et j’ai demandé à un chouette metteur en scène de le mettre en scène. Ça a très bien marché et j’ai continué à écrire et jouer des pièces.
- Quels livres vous ont particulièrement marquée ?
Je crois fondamentalement, que le livre donne une vie supplémentaire.
Moi je suis une fana de La recherche du temps perdu de Marcel Proust.On avait un prof en rhéto au collège qui nous a donné cours pendant deux mois sur la recherche du temps perdu ; on le trouvait vraiment ringard et on riait pendant son cours ; à la fin du cours, il a dit : « Riez bien mais il y a quelqu’un dans cette classe qui lira toute la recherche du temps perdu ; c’est toujours comme ça quand je donne ce cours et c’est d’ailleurs pour ça que je le donne. » Et moi à 23 ans, j’ai tout lu !! Et après j’ai recroisé ce professeur et c’est vrai que je lui dois beaucoup. Récemment je devais négocier avec une personne néerlandophone pour organiser des lectures et le mon de ma compagnie est Albertine, c’est le nom de l’héroïne de la recherche du temps perdu. Donc on parle et puis à la fin elle me pose une question : « Pourquoi votre compagnie s’appelle l’Albertine ? » Je lui réponds : « Vous connaissez Marcel Proust ? » Et là elle me répond : « Ah oui !! Je m’en doutais !! » Elle était complément emballée et puis le reste de l’interview nous n’avons parlé que de ça comme si Albertine était une cousine à nous, pour nous ça avait tellement de réalité et je me suis dit : ça existe en fait. L’imaginaire pour autant qu’on lui donne de la valeur est aussi important que le réel, l’imaginaire permet de rester heureux, les livres nous font rêver, ils nous emmènent dans l’imaginaire et on voyage.
- Pourquoi ces nombreux remerciements au début du livre ? Quel rôle ont joué ces gens dans l’écriture ?
Le premier c’est mon mari ; si je ne le cite pas il me fait la peau (rire), le second c’est quelqu’un avec qui j’ai eu une correspondance et qui m’a dit après que j’ai envoyé le texte aux éditeurs qu’il aimerait bien le lire, ensuite il y a une collaboratrice de ma compagnie.
Ce sont toujours des gens qui m’ont soutenue moralement.
Il y a mon premier éditeur de théâtre, il a fait un truc extraordinaire, il a demandé à une stagiaire de faire une fiche de lecture, alors qu’il avait beaucoup de travail à lui faire faire. Donc elle a tout analysé, elle a fait un résumé du bouquin et quand Luce Wilquin a publié, elle m’a demandé un résumé du livre, je lui ai envoyé celui de cette stagiaire.
Puis il y a Michel Lambert, au début j’ai envoyé mon manuscrit à toutes les maisons d’édition en France, mais en fait il m’a expliqué, alors que je n’y connaissais rien, qu’il ne fallait jamais faire ça. Quand vous envoyez un manuscrit dans une maison d’édition, au départ il est lu par ceux qu’on appelle les lecteurs, ensuite ils remettent une note de lecture, si elle est positive, elle passe au comité de lecture et on relit tout.
Mais les lecteurs dans les maisons d’édition françaises sont très mal payés, ce qu’ils font, c’est de se faire engager par plusieurs maisons d’édition, mais si vous envoyez vos manuscrits la même semaine, ils vont prendre votre manuscrit dans chaque maison d’édition où ils travaillent et vont faire une seule fiche de lecture et se feront payer quatre fois pour le même travail.
Donc Michel Lambert m’a dit qu’il fallait que j’envoie un ou deux manuscrits une semaine et d’autres quelques semaines après pour tomber sur d’autres lecteurs qui liront peut-être plus que les précédents. Ensuite j’ai tenté ma chance en Belgique, et je me suis demandé à qui je pourrais envoyer mes manuscrits, et il m’a dit que je pouvais lui envoyer mais que ça ne serait pas lui qui s’en occuperait mais sa collaboratrice, comme ça, l’avis serait neutre, je l’ai aussi envoyé à Luce Wilquin. Un jour en rentrant chez moi il me téléphone, et me dit qu’il le prend, en même temps je regarde mes mails et je vois un message de Luce Wilquin qui me dit qu’elle le prend.
Seulement je m’étais engagée avec Michel Lambert, j’ai donc téléphoné à Luce Wilquin pour lui dire que j’avais dit oui à Michel Lambert, elle m’a demandé si j’avais officiellement signé avec lui, je lui ai répondu que je n’avais pas encore signé. Elle m’a dit « tant que vous n’avez pas signé avec Michel Lambert je garde le manuscrit et il parait en septembre, le jour où vous signez vous me téléphonez et je jette le manuscrit à la poubelle. »
Le lendemain je sonne à Michel Lambert je lui demande s’il va m’envoyer le contrat et il répond que je l’aurai dans la semaine, un mois après toujours rien. Il me fait traîner six mois.
J’appelle François Emmanuel qui me dit que les éditions pour lesquelles travaille Michel Lambert sont au bord de la faillite, alors j’appelle la promotion des lettres au ministère, et ils me disent qu’il ne faut pas que je signe avec eux. Alors j’ai pris mon téléphone, j’ai téléphoné à Luce Wilquin pour lui dire que je n’avais pas encore reçu de contrat, que je me sentais déliée de ma parole envers Michel Lambert. Elle m’a dit que ça ne changeait rien, que pour elle mon bouquin paraissait toujours en septembre. J’ai donc téléphoné à Michel Lambert pour lui dire que j’avais signé avec Luce Wilquin, il m’a dit qu’il n’osait pas me dire que sa maison était en faillite et que c’était la meilleure chose que je puisse faire.
- Qu’avez-vous ressenti lorsque vous avez reçu le prix Rossel ?
Déjà, chaque année je regardais le prix Rossel et pour moi c’était inaccessible. Et donc mon éditrice, un jour me dit qu’elle a envoyé mon roman au prix Rossel et que je n’ai aucune chance. Un mois avant cette grande cérémonie, je suis invitée à une interview, à un moment le monsieur de l’interview me dit : « On parle de vous pour le prix Rossel… » J’étais abasourdie. Puis on me téléphone et on me dit qu’un membre du jury voulait que je sache qu’il aimait beaucoup le livre. Je me dis : « S’ils me disent ça, c’est qu’ils n’ont pas l’intention de retenir le livre mais ils voulaient que je sache leurs opinions. » Une semaine avant ce fameux prix, je regarde le journal pour voir les nominés et j’apprends que je suis l’un d’entre eux et ce jour-là j’ai un coup de téléphone d’une journaliste qui me demande si je suis contente, alors là je pense que je n’ai aucune chance car ces personnes nominées, ce sont des auteurs très importants avec de grosses productions et là elle me dit : « Détrompe-toi, tu es la favorite mais tout peut encore basculer. » Et enfin le jour du prix Rossel à douze heures ils m’ont appelée et j’ai enfin su le verdict ; en même temps tout s’arrête car même si on pense que c’est possible extraordinaire, on n’arrive pas à y croire. Des gens tellement remarquables ont eu ce prix !